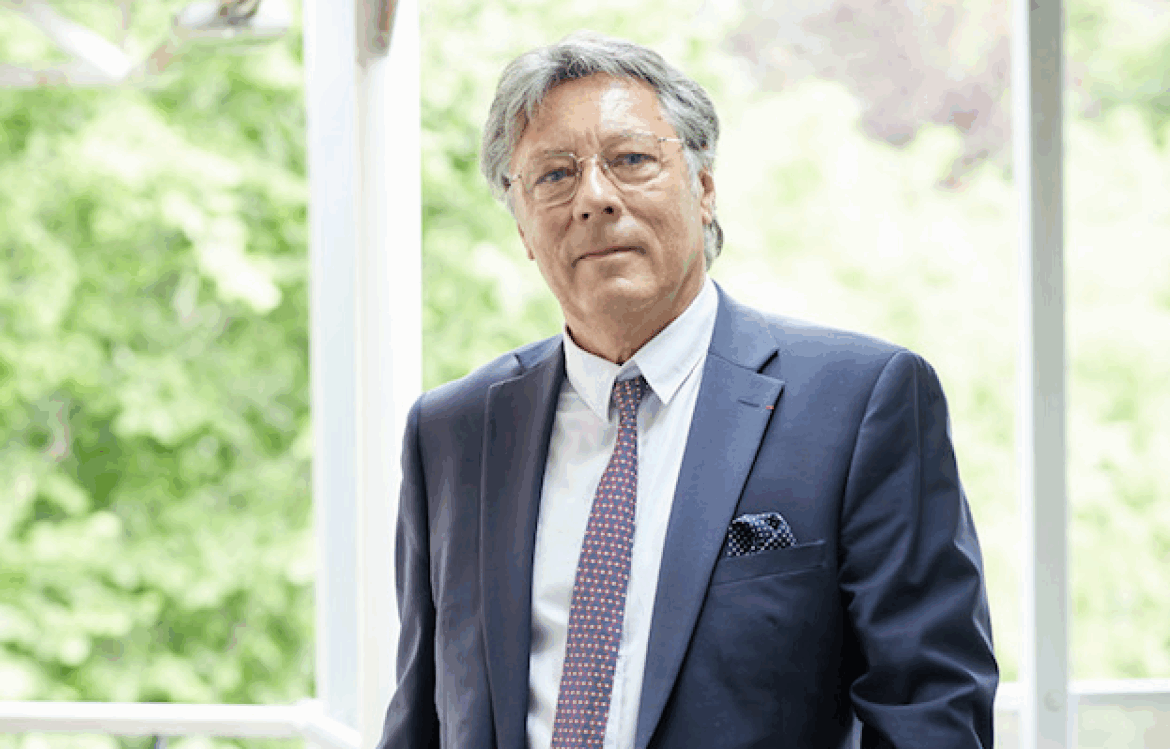Revenu aux affaires pour un management de transition à la tête de l’Eigsi à la Rochelle, Jean-Michel Nicolle fut de 2008 à 2023 l’emblématique directeur de l’EPF mais aussi, de 2015 à 2020, le président de l’Union des Grandes écoles indépendantes (UGEI). Depuis 2023 il est conseiller auprès de la DGESIP (Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle) où il contribue à la réflexion sur l’enseignement supérieur privé. Il réfléchit avec nous sur le modèle économique des écoles en général et de l’Eigsi en particulier.
LE MODELE ECONOMIQUE DES ECOLES D’INGENIEURS
Olivier Rollot : Vous évoquez souvent la question de la taille critique des écoles d’ingénieurs. En quoi est-ce aujourd’hui un enjeu central ?
Jean-Michel Nicolle : C’est d’abord un constat : la taille moyenne d’une école d’ingénieur est passée de 284 élèves en 1988 à 422 en 2008 à 1000 en 2025. Ce phénomène résulte de plusieurs causes, dont la forte croissance du nombre de primo entrants dans l’enseignement supérieur, l’augmentation du nombre d’écoles postbac offrant 5 années de formation au lieu de trois pour les autres, l’ouverture de nouvelles formations ou labels, ou encore le développement de campus délocalisés, qui ont favorisé la croissance interne des écoles. A cela s’ajoute, et c’est probablement le phénomène le plus remarquable depuis 10 ans, la place prise par des groupes visant des tailles critiques d’organisation bien supérieures pour bénéficier d’effets favorables sur leurs coûts « de production », et donc de profitabilité, mais aussi de synergies entre leurs établissements. Une partie du modèle économique de ces groupes est fondé sur leur capacité à mutualiser des fonctions supports.
On voit aujourd’hui des ensembles diversifiés qui associent écoles d’ingénieurs, de management ou autres établissements, partageant leurs coûts de structure voire une partie de leurs offres. Il y a quelques années, la référence en taille était l’INSA, désormais certaines écoles privées, qui développent des stratégies de croissance externes par intégrations ou acquisitions, atteignent une taille supérieure.
Dans notre secteur, les activités marchandes, principalement de formation, se combinent avec des activités non marchandes qui relèvent de la responsabilité sociale de l’école, de la prise en charge des diversités, d’une recherche à impact ou encore de la mise en œuvre d’une politique de développement durable. Le contexte d’innovation mais aussi l’environnement international dans lesquels elles évoluent imposent des investissements important et récurrents, en particulier dans les écoles généralistes ou au caractère industriel marqué.
Nos écoles doivent se doter d’un socle minimal de moyens pour assurer leurs missions et répondre aux exigences réglementaires et professionnelles. Elles supportent des charges de structure quasi incompressibles : ressources humaines, direction administrative et financière, services informatiques, sécurité, maintenance, achats. On comprend donc que la capacité à maitriser les coûts est aussi critique que le développement du chiffre d’affaires !
Alors que nous prônons dans nos missions sobriété, parfois même frugalité, la croissance de certaines écoles se fonde sur des dépenses discrétionnaires en marketing digital ou en services informatiques dont l’intérêt pour l’étudiant est parfois discutable. Certains postes représentent néanmoins de véritables leviers de création de valeur. C’est le cas du support aux plateformes numériques, à la cybersécurité ou aux équipements numériques pour la pédagogie qui sont devenus indissociables de la qualité de l’offre de formation.
Il n’en reste pas moins que la conséquence est, pour le secteur, une production de fait de normes de charges qui finissent par peser sur les comptes de résultat des écoles les plus petites. Ce phénomène est aggravé par les difficultés économiques, parfois le désengagement, de certaines collectivités territoriales qui soutenaient traditionnellement la création et le développement de nos écoles.
Nous atteignons donc un point où seules les écoles qui disposeront d’une taille critique suffisante pourront répondre durablement aux exigences d’un marché caractérisé par un phénomène de surenchère au cœur d’une concurrence de plus en plus forte.
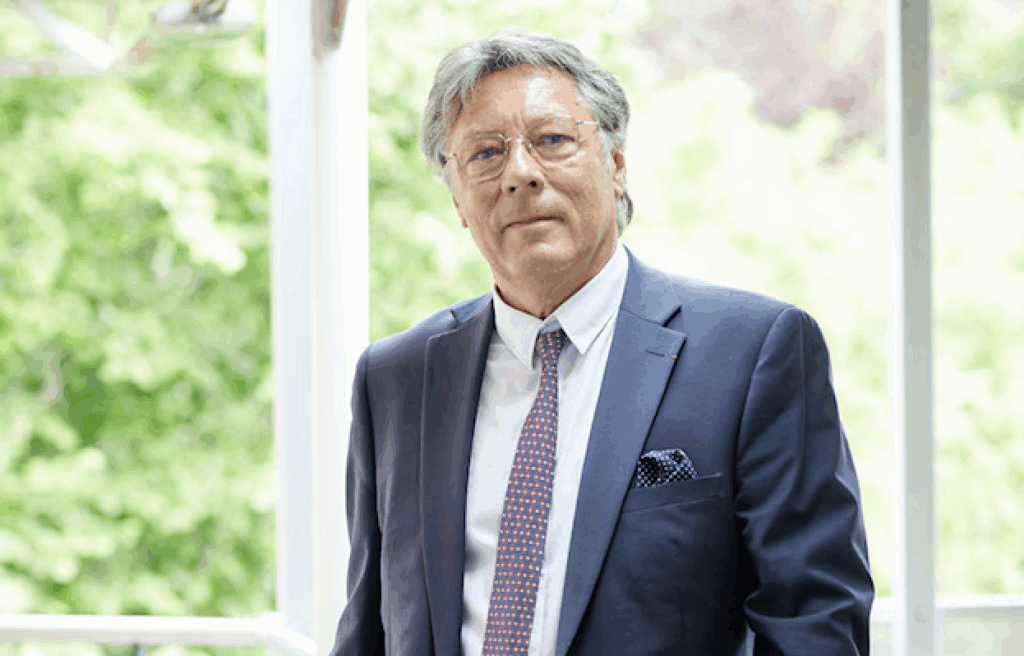
O. R : Les écoles de petite taille peuvent-elles jouer sur d’autres leviers que la mutualisation des coûts ?
J-M N.: Très peu. Le prix de marché limite pour les formations d’écoles d’ingénieurs privées peut être évalué entre 9 000 € et 11 000 € par an, selon la localisation. Seule une marque très forte pourrait offrir un potentiel de hausse supérieur.
Alors que les écoles de management ont su diversifier leurs portefeuilles avec des bachelors, BBA, programmes internationaux ou doubles diplômes, ont étendu leur marché vers de nouveaux secteurs comme le tourisme, le luxe ou l’hospitality, les écoles d’ingénieurs restent trop souvent « mono-produit » en proposant le seul diplôme d’ingénieurs, dans un marché de la formation initiale qui se contracte. Les stratégies multi-campus qui permettent de lisser les risques et d’accroître la visibilité des marques ne sont le fait que de quelques écoles.
Aujourd’hui, un modèle économique fondé sur une seule offre, un seul site et un seul public n’est plus soutenable, sauf bien sûr quand la différentiation de l’école est remarquable.
O. R : Quelles sont les contraintes les plus lourdes pour une école d’ingénieurs aujourd’hui ?
J-M N.: Les charges de personnel représentent souvent entre 60 % et 65 % des dépenses d’exploitation d’un établissement. Dans certaines écoles de petite taille, ce taux peut atteindre 75 %. Cette structure de coût n’est pas soutenable et dégage trop peu de marge brute pour financer les loyers, les charges externes, les amortissements, les dépenses pédagogiques ou la communication. Et le résultat ne permet plus alors de financer l’investissement.
Une action pour réduire ces charges incompressibles est quasiment impossible. Elles relèvent, pour la plupart, du cahier des charges d’une école d’ingénieurs et de l’application du référentiel de la CTI, comme un taux d’encadrement. La seule voie interne d’équilibre économique reste la croissance, le plus souvent avec de nouveaux produits, en complément de ceux résultants des formations d’ingénieurs.
La taille critique devient un impératif pour amortir les coûts de structure et préserver la qualité.
UNE TRANSFORMATION STRUCTURELLE DU PAYSAGE
O. R : Y a-t-il aujourd’hui un risque de saturation du marché des écoles d’ingénieurs ?
J-M N.: En 2024, plus de 25 000 places étaient proposées dans les écoles d’ingénieurs, mais plus de 20% d’entre elles restaient étaient vacantes au début de la procédure complémentaire Parcoursup. Plus d’une centaine de formations n’ont pas pu ouvrir ouvert faute d’effectifs insuffisants.
Nous sommes donc en face d’un paradoxe : alors que le discours public appelle à former davantage d’ingénieurs, les capacités existantes ne sont pas saturées.
Les raisons de cette situation sont multifactorielles et s’expliquent en partie par la montée en puissance des titres RNCP de niveaux 6 et 7. Entre 2019 et 2024, le nombre d’apprenants est passé de 120 000 à plus de 330 000. Ces formations captent une part substantielle de candidats dont certains auraient pu se tourner vers nos écoles d’ingénieurs. En parallèle, les effectifs dans nos cycles de formation n’ont progressé que marginalement.
À cela s’ajoute la concurrence d’offres hybrides, très bien positionnées sur le plan marketing, qui mêlent ingénierie, management, numérique et design. Ce sont des formations attractives pour des étudiants en quête de flexibilité et de reconnaissance rapide sur le marché de l’emploi.
O. R : Les écoles d’ingénieurs souffrent-elles d’un déficit de culture marketing pour recruter leurs élèves ?
J-M N.: Clairement. Historiquement, nous avons investi dans la recherche, les enseignants-chercheurs, les laboratoires et les équipements techniques. C’est ce qui a fait notre identité, notre force, mais aussi notre vulnérabilité : nous n’avons pas su faire évoluer nos stratégies de communication et d’attractivité.
Pendant longtemps, le marché était en croissance, prévisible et équilibré entre établissements. Mais ces dernières années, des stratégies de volume et de diversification très offensives ont été développées par les groupes : ouvertures de campus dans plusieurs villes, gammes de formations étendues, communication ciblée.
Les écoles plus traditionnelles, comme l’EIGSI ou d’autres établissements indépendants, ont été prises de court.
O. R : Peut-on parler d’un véritable changement de culture dans l’enseignement supérieur ?
J-M N.: Nous évoluons dans un environnement de liberté de l’enseignement fixé par notre Constitution, la loi de 1875 et le Code de l’Education. Pendant longtemps, les implantations d’établissements étaient régulées de manière implicite. Nous sommes entrés dans un monde beaucoup plus concurrentiel et le principe de liberté d’installation facilite les stratégies de déploiement territorial de groupes privés disposant, souvent grâce à l’emprunt, de capacités de financement importantes.
Certaines écoles, restées sur une posture locale, dans un modèle moins entrepreneurial, plus « académique », ont tardé à percevoir ce virage. Nous nous étions calqués sur les modèles publics, avec une croissance maîtrisée, parfois même freinée. Ce paradigme est révolu. Désormais, la survie d’une école dépend de sa capacité à prendre des risques, à investir, se rendre visible, innover dans son offre, à se déployer et surtout à intégrer de nouveaux espaces de coopération.
LA SATURATION DU VIVIER ET LA QUESTION DES NOUVEAUX PUBLICS
O. R : Peut-on élargir le vivier des candidats ?
J-M N.: Il faut le réussir, absolument. La baisse démographique à venir et la régulation des flux d’étudiants étrangers limitent les marges de manœuvre. Nous devons explorer de nouvelles voies : la validation des acquis de l’expérience (VAE), rechercher les publics issus de bacs technologiques ou professionnels, pourquoi pas certaines certifications RNCP, accompagner les reconversions et surtout adresser la formation tout au long de la vie. Les établissements allemands ont vécu bien avant nous ce bouleversement démographique et ont parfaitement réussi leur reconversion.
Aujourd’hui, nos écoles d’ingénieurs travaillent insuffisamment ces segments. Pourtant, beaucoup de techniciens ou cadres intermédiaires pourraient accéder au diplôme d’ingénieur avec un accompagnement adapté. C’est un levier de diversification essentiel.
O. R : La création de campus à l’international est-elle un modèle d’avenir ?
J-M N.: L’EIGSI forme déjà des ingénieurs sur notre campus de Casablanca, parfaitement intégrés au modèle français. Cette externalisation répond à la fois à la pénurie de candidats en Europe et au dynamisme du marché africain.
L’Afrique, avec plus de deux milliards et demi d’habitants, représente un vivier considérable, elle est un relai de croissance pour nos entreprises comme pour nos écoles. Nous devons y être présents non pas comme opérateurs venus “du Nord”, mais bien comme partenaires dans la formation et la production d’ingénieurs pour l’Afrique mais aussi pour l’Europe.
O. R : Le profil des ingénieurs formés doit-il évoluer ?
J-M N.: Nous devons repenser nos méthodes pédagogiques pour transformer des jeunes venus d’horizons variés — pas uniquement des scientifiques « classiques » — en ingénieurs capables de comprendre les systèmes complexes du monde industriel dans la société de demain.
Cela suppose d’introduire davantage de pluridisciplinarité, d’apprentissage par projets, d’innovation, d’exposition aux environnements technologiques réels et virtuels dans des espaces culturels et sociaux pluriels. L’ingénieur de demain devra combiner compétences techniques, littératie numérique, sens du design, de l’écoconception et de l’innovation responsable et bien sûr de la sobriété. Mais il sera surtout doté de nouvelles compétences, essentiellement des soft-skills, qui lui permettront d’établir un nouveau rapport avec des technologies du futur dotées d’intelligence artificielle.
REPOSITIONNER L’EIGSI : ATTRACTIVITE, INNOVATION, ALLIANCES
O. R : Six mois après votre arrivée à la direction de l’Eigsi quel rapport d’étonnement en feriez-vous ?
J-M N.: J’ai découvert une école au caractère trempé, dotée de pépites qui ne demandent qu’à briller, des équipes engagées, des équipements de qualité, une recherche bien positionnée et une culture de qualité remarquable. Elle dispose de tous les ingrédients pour produire un ingénieur durable.
L’ingénieur formé à l’EIGSI, est parfaitement aligné avec un modèle d’ingénieur polytechnicien qui imagine, conçoit, fabrique, dans un rapport de proximité avec la matière, l’outil, les usages. Par sa formation et ses compétences, il est prêt à évoluer dans un espace de projets et un environnement de complexité. Ce profil, qui cultive un rapport au concret, me rappelle celui des ingénieurs ENSAM. Il évolue dans un environnement hautement technologique mais reste capable de résoudre des problèmes dans un souci de frugalité.
Et la présence d’un incubateur, qui a contribué depuis 25 ans à accompagner plus de 150 créations d’entreprise, nourrit probablement une sensibilité entrepreneuriale chez certains d’entre eux.
C’est exactement le profil d’ingénieur dont notre société a besoin.

O. R : Quelle est votre mission à la tête de l’Eigsi ?
J-M N.: Ma mission est de gérer une transition. Mon temps est compté et mon intention est d’allumer une étincelle, remettre en cohérence les énergies, permettre à l’EIGSI de retrouver une position qui s’est affaibli dans le temps, aligner les potentiels avec une ambition. En peu de temps une confiance en l’avenir s’est construite, et demain nous serons fiers qu’une nouvelle dynamique se soit installée. Je constate que cette école en intéresse d’autres et c’est pour moi la meilleure motivation pour lui donner un nouveau souffle.
L’EIGSI, c’est historiquement une grande école du génie des systèmes industriels. Or, ces dernières années, la croissance des écoles d’ingénieurs s’est principalement concentrée sur le secteur numérique, un numérique qui faisait rêver les jeunes : c’était un secteur attractif, bien rémunéré, en plein essor.
De nombreuses écoles concurrente à l’EIGSI sont positionnées sur ce créneau de spécialité même si elle se revendiquent « généralistes » … du numérique. J’ai l’impression qu’un retournement de tendance est amorcé. Peut-être le résultat d’une saturation de l’offre, peut-être un environnement géopolitique incertain qui nous ramène à la réalité et l’importance des objets physiques ?
Les enjeux contemporains — défense, drones, souveraineté technologique — montrent que nous avons un besoin croissant d’ingénieurs capables de concevoir et de produire des systèmes industriels complexes, intégrant bien sûr de l’informatique embarquée, de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité. Je crois profondément qu’il y a un avenir pour ces écoles d’ingénieurs industrielles « à la française », qui ont su se moderniser sans renier leur ADN.
Aujourd’hui, les écoles dont les formations sont à vocation industrielle deviennent plus attractives. C’est un vrai signal : assiste-t-on à un changement de cycle ?
J’entends bien que l’EIGSI profite de ce mouvement tout en intégrant une dimension numérique et cyber bien plus forte.
O. R : Quelles sont les grandes lignes de la stratégie que vous menez aujourd’hui à l’EIGSI ?
J-M. M. : Elle repose sur quatre axes : attractivité, transformation pédagogique, élargissement de l’offre et alliances.
D’abord, l’attractivité : nous avons retravaillé l’identité de marque, le logo, pour qu’il traduise le renouveau, la modernité et l’élan d’une école focalisée sur les grands enjeux écologiques et technologiques — durabilité, transition énergétique, santé, éco-conception – et un slogan pour affirmer une posture engagée : « Inventer un futur durable ».
Ensuite, la transformation numérique et organisationnelle : nous passons d’un modèle de coopération entre nos campus de La Rochelle et Casablanca à une école véritablement globale. Nous avons deux campus aujourd’hui et un troisième est à l’étude en France pour 2026.
Le troisième axe concerne l’offre de formation : nous avons lancé de nouvelles filières — médecine augmentée, éco-conception du bâtiment, aéronautique et naval durables — qui replacent l’ingénierie au cœur des transitions industrielles et écologiques. L’idée, c’est de recontextualiser les formations, leur instiller une culture recherche plus visible, étendre l’offre en amont et en aval des formations d’ingénieurs pour les ancrer au cœur des défis du futurs. Cette réforme est engagée et son impact sera largement perceptible dès la prochaine rentrée.
Je vis ma mission de transition non comme un statu quo en attendant un ou une successeur (se), mais comme une opportunité pour éclairer tous les potentiels de cette école dans un temps court. Cette aventure est pour moi un concentré d’expérience.
Enfin, les alliances : nous travaillons avec des partenaires du territoire comme EXCELIA avec qui nous partageons déjà un comité de direction pour orienter des stratégies conjointes, mais aussi avec des écoles d’ingénieurs. Je crois aux vertus d’une l’alliance fondée sur une socle de valeurs communes, une vision partagée, des complémentarité qui créent de la valeur collective et une volonté de mutualiser, partager, créer des synergies en totale confiance.
C’est le cas avec l’ESIGELEC, EPF et 3iL par exemple. Le réseau est un mode d’organisation qui offre de multiples opportunités. C’est l’esprit qui avait prévalu lors de la création de EUPHE, premier réseau européen d’organisations représentatives de l’enseignement supérieur privé.
LES PERSPECTIVES DU SECTEUR
O. R : Quelles sont, selon vous, les évolutions majeures à venir pour les écoles d’ingénieurs ?
J-M N.: Nous sommes dans une phase de recomposition. Certaines écoles vont être absorbées, d’autres disparaîtront. Le paysage va se consolider autour d’acteurs capables de tenir économiquement, de se projeter et d’investir.
L’État est engagé dans une action qui permettra d’assurer une meilleure régulation et sécurité du marché en favorisant une plus grande transparence. C’est une exigence démocratique qui passe, par exemple, par la publication des comptes individuels et consolidés des entreprises et des groupes.
Je reste optimiste : il y a un bel avenir pour les écoles d’ingénieurs françaises, les opportunités ne manqueront pas. L’industrie revient au centre du jeu ; les besoins en ingénieurs sont considérables mais ne seront pas satisfaits sans une réinvention de notre modèle.
Mais nous ne sommes plus en zone de confort. Nos concurrents ne sont plus les seules écoles d’ingénieurs mais d’autres offres de formation qui jouent sur l’indifférenciation : écoles de management qui investissent le champ de la technologie, certifications qui occupent les domaines de spécialité de nos écoles, universités qui professionnalisent leurs formations, et surtout l’international qui devient une alternative pour notre jeunesse. Pourtant, pour connaitre l’enseignement supérieur privé en Europe, je peux affirmer que nos écoles sont largement au niveau de nos concurrents internationaux !
L’EIGSI a les atouts pour s’inscrire dans ce mouvement : un ancrage industriel fort, une expertise technique reconnue, une dimension internationale et une capacité à se réinventer. Il ne reste plus qu’à identifier et accompagner la directrice ou le directeur qui aura le plaisir, j’en suis convaincu, d’écrire une nouvelle page d’histoire de cette école attachante.