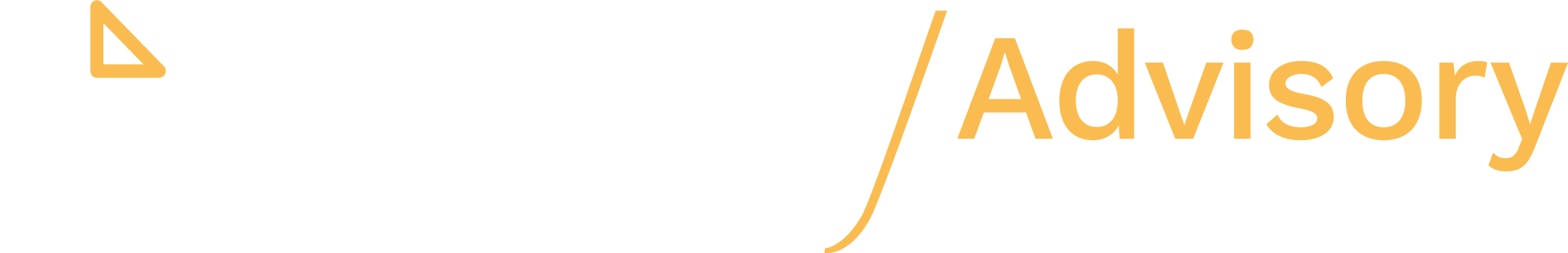La moitié des 25-34 ans n’est pas diplômée de l’enseignement supérieure en 2024 Source : Les chiffres clés de la jeunesse 2024 (Injep)
Les étudiants, des jeunes comme les autres ? C’est autour de cette question que s’est tenue, jeudi 27 mars, la première édition des Rencontres de l’OVE, un nouveau cycle d’échanges que l’Observatoire de la vie étudiante consacre à la condition étudiante du 21ᵉ siècle. Il ambitionne de « créer un lieu de discussion entre les chercheurs et les responsables politiques, afin de jouer le jeu du dialogue et de faire avancer le débat » explique Olivier Rey, Président de l’OVE.
Deux sociologues, Camille Peugny et Perrine Agnoux, et le délégué interministériel à la jeunesse, Thibault de Saint Pol, se sont donc réunis à cette occasion pour interroger la place et les spécificités des étudiants dans la jeunesse.
Définir la jeunesse est un défi périlleux. Comme le souligne Thibault de Saint Pol « il est réducteur de penser qu’un âge suffit pour la définir, notamment parce que la jeunesse s’allonge, se constitue de plusieurs étapes, et d’aller-retours souvent jusqu’à 30 ans ». Pour Camille Peugny aussi, il serait plus intéressant de partir de l’expérience de la jeunesse pour en esquisser une définition : « être adulte pourrait par exemple se définir par le niveau d’autonomie, ou encore l’insertion sur le marché du travail. » Toutefois, les sociologues notent une hétérogénéité très marquée dans les trajectoires de la jeunesse, ne permettant pas de dégager une expérience unique qui la caractériserait. Perrine Agnoux revient alors sur « les très nombreux facteurs expliquant cette hétérogénéité : le genre, l’origine sociale, les origines ethniques, le fait d’être motorisé, l’âge de la mise en couple, le soutien des parents… ».
Le modèle estudiantin n’est pas majoritaire et reste loin de nombreuses réalités vécues par les jeunes. Il faut en effet avoir conscience, certes de l’ampleur, mais aussi des limites de la massification scolaire. La moitié des 25-34 ans n’est pas diplômée de l’enseignement supérieure en 2024. A cela s’ajoute un autre problème de la massification, « c’est la sortie des études sans qualification qui concerne environ 90 000 à 100 000 jeunes chaque année » précise Camille Peugny. Le modèle étudiant n’est donc pas la norme de toute la jeunesse, et c’est à partir de ce constat que les politiques publiques doivent être manœuvrées. Thibault de Saint Pol en décrit d’ailleurs les enjeux : « même si elles peuvent être perçues comme un millefeuille de dispositifs, les politiques publiques correspondent, en fait, à la multiplicité des situations », c’est sur leur lisibilité qu’il faut travailler. Il souligne par ailleurs le rôle incontournable des acteurs associatifs pour réussir l’accompagnement des jeunes, en visant une approche plus individuelle.
Une mosaïque d’expériences étudiantes. Même au sein de la population étudiante, les expériences vécues sont fragmentées. Par exemple, l’expérience des étudiants, notamment dans les grandes villes, est souvent perçue comme la norme, mais elle ne reflète qu’une partie de la réalité. Perrine Agnoux, qui a étudié les jeunes femmes des classes populaires en milieu rural, évoque leur « difficulté à se reconnaître dans les représentations étudiantes de la jeunesse malgré un parcours d’étude ». Les inégalités sociales fracturent la population étudiante et multiplient les nouveaux défis. Par exemple, bien qu’ils ne représentent qu’un tiers de la population étudiante, les jeunes issus des classes populaires sont de plus en plus nombreux. «La précarité étudiante est une minorité, mais une minorité qui grossit », résume alors Camille Peugny.
Ce phénomène peut aussi exacerber les problématiques de santé mentale. En effet, ces étudiants, plus précaires, se retrouvent dans une situation paradoxale, pouvant alimenter considérablement leur stress au cours de leurs études. Ils ressentent un « empressement à la diplomation […] pour ne pas perdre d’année », car ils dépendent financièrement de leur famille. Pourtant, ils sont conscients qu’ils ne disposent pas des mêmes ressources pour mener à bien cette « course décisive au diplôme ».
La pertinence et l’importance de la catégorie « jeunesse ». Ces constats faits, Camille Peugny souligne néanmoins le risque de réduire la question et de penser que « parler de la jeunesse ne veut rien dire ». En effet, la jeunesse s’inscrit tout de même dans des dynamiques partagées, telles que « la vie sous une forme d’urgence » ou une « collaboration étroite avec la famille ». C’est précisément sur ce dernier aspect que reposent les politiques publiques françaises de la jeunesse : familialistes, elles maintiennent un lien étroit entre les individus et leur famille jusqu’à leurs 25 ans. Cela révèle combien la définition de la jeunesse est importante, puisqu’elle impacte directement l’orientation des politiques publiques.
Pour aller plus loin :
- Les chiffres clés de la jeunesse 2024 (Injep)
- Peugny, C. (2020). Générations, Jeunesses et Classes Sociales un Quart de Siècle D’analyse des Inégalités. Agora débats/jeunesses, 86(3), 11-24.https://shs.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2020-3-page-11?lang=fr
- Entretien avec Peugny, C., Tiberj, V., Propos recueillis par Colin-Madan, É. (2023). Pour En Finir Avec une Vision Désenchantée de la Jeunesse. L’Observatoire, 60(1), 7-12. https://shs.cairn.info/revue-l-observatoire-2023-1-page-7?lang=fr