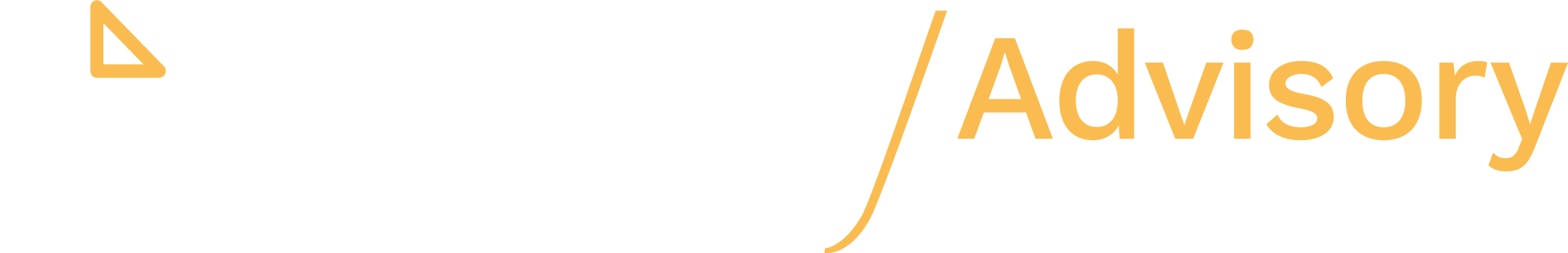«Au-delà d’être un lieu de passage, comment faire du campus de demain un lieu de vie pour les étudiants?»
Les 19 et 20 novembre 2024 s’est tenu à la Cité Internationale Universitaire de Paris le premier Salon de l’Expérience Étudiante co-organisé par HEADway Advisory, cabinet de conseil spécialisé dans le secteur de l’enseignement supérieur, et la société spécialiste des salons RPI. A ce salon réservé aux professionnels de l’enseignement supérieur ont été présents l’ensemble des acteurs de l’expérience étudiante afin d’éclaircir les enjeux et composantes de l’expérience étudiante et apporter des solutions pour l’améliorer.
Nous vous proposons cette semaine un retour sur la conférence portant sur le « Campus de demain » pendant laquelle experts et praticiens ont discuté des nouveaux enjeux liés à l’aménagement des espaces d’enseignement supérieur.
- Le prochain Salon de l’expérience étudiante aura lieu les 25 et 26 mars 2026.
 Qu’est-ce qu’un campus durable ? Si la performance énergétique est essentielle, la flexibilité des espaces et la co-conception avec les étudiants sont également des facteurs clés pour répondre aux besoins actuels et futurs. Les étudiants sont de plus en plus attachés à ce que le campus réponde à une expérience étudiante durable. José Milano, président exécutif du groupe OMNES Education, introduit le concept de campus de demain en mettant en avant 4 enjeux auxquels doivent faire face les établissements : la rénovation des espaces actuels, la variabilisation des coûts et la pérennité financière des établissements, la modularité des espaces ainsi que le rôle du campus dans l’ouverture au monde environnant.
Qu’est-ce qu’un campus durable ? Si la performance énergétique est essentielle, la flexibilité des espaces et la co-conception avec les étudiants sont également des facteurs clés pour répondre aux besoins actuels et futurs. Les étudiants sont de plus en plus attachés à ce que le campus réponde à une expérience étudiante durable. José Milano, président exécutif du groupe OMNES Education, introduit le concept de campus de demain en mettant en avant 4 enjeux auxquels doivent faire face les établissements : la rénovation des espaces actuels, la variabilisation des coûts et la pérennité financière des établissements, la modularité des espaces ainsi que le rôle du campus dans l’ouverture au monde environnant.
La nécessité de combiner durabilité écologique et hybridation des espaces. Jérôme Lebrun, directeur de Builders, école d’ingénieurs labellisée DD&RS, répond à la question « Comment assurer la durabilité sur les campus » en évoquant deux axes majeurs. En premier lieu, l’architecture doit intégrer des matériaux durables, des énergies renouvelables, et une gestion optimisée des ressources de telle manière à ce que les bâtiments produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment. En parallèle, la durabilité doit aussi être une question de modularité des espaces dans le temps.
A travers l’exemple de la modularité pédagogique, Jérôme Lebrun insiste sur le fait que cela transforme les campus en laboratoires vivants où « étudiants et enseignants co-créent des solutions écologiques » et « adaptent leurs pratiques pour avoir des campus durables et exemplaires ». Il rappelle également les exigences en matière de durabilité des règlementations environnementales, labels et certifications comme le label DD&RS et la règlementation RE2020 s’imposant à l’ensemble des constructions neuves.
Comment prévoir la modularité des espaces dès leur conception ? La modularité est essentielle pour créer des campus capables d’évoluer avec le temps. Lucille Pereda-Le Blanc, cheffe de projets chez Mott MacDonald, bureau d’études et de conseil en ingénierie présent dans l’éducation qui a notamment travaillé sur le projet de nouveau campus de TBS Education, explique ainsi que « la flexibilité des espaces peut se traduire par des cloisons mobiles, du mobilier modulable, et des réseaux d’alimentation modulaires pour adapter les infrastructures aux usages pédagogiques ». Ce type de conception permet de transformer un espace pour répondre à des besoins variés : salles de classe, ateliers collaboratifs, espaces de détente, ou même événements ponctuels. L’enjeu principal reste, selon elle, de construire un campus modulable à moindre coût.
Pour Jérôme Lebrun, la modularité est aussi indispensable pour déployer des innovations pédagogiques. Elle permet de créer des configurations d’espaces adaptables, favorisant « la mise en situation des élèves par les travaux pratiques », réel enjeu pour les écoles d’ingénieurs comme la sienne. Ces espaces flexibles soutiennent l’évolution des méthodes d’enseignement et offrent une plus grande interaction entre les étudiants.
Matey Karassimeonov, directeur du développement à Aken Ecosystèmes, entreprise conceptrice et propriétaire d’un écosystème apprenant baptisé « Arbres d’Aken », insiste aussi sur l’importance de « l’hybridation des savoirs et de la mutualisation des espaces » deux piliers d’engagement pour répondre aux besoins des apprenants, des entreprises, des habitants et usagers d’un territoire. En effet, cette approche favorise la collaboration entre étudiants, enseignants et grand public, écoles et collectivités locales, créant des synergies bénéfiques pour tous.
Mais qu’en est-il du processus de conception des campus ? La programmation est une étape clé dans la conception des campus. Lucille Pereda-Le Blanc rappelle que cette phase permet de « définir les objectifs du projet, en conciliant budget, flexibilité et contraintes (sociales, techniques, environnementales) ». Une attention particulière doit être accordée à la gestion des coûts annexes, tels que l’inflation ou les risques liés à la conception. Elle rappelle qu’il est donc impératif de travailler en étroite collaboration avec les acteurs de l’enseignement supérieur pour trouver un compromis optimal entre les besoins et les ressources disponibles.
Pour mieux estimer les coûts annexes du campus et de ses espaces et prévenir tous les risques, Frédéric Meunier, directeur général de EFREI, précise ainsi que son école d’ingénieurs a choisi de distinguer les budgets pour les différents types d’espaces : « Les espaces de travail, souvent soumis à des contraintes réglementaires qui limitent la marge de manœuvre créative possible dans ces espaces, bénéficient d’un budget plus serré, tandis que les espaces de vie ont un budget plus important pour offrir des lieux de convivialité et d’innovation ».
Quels acteurs dans la conception des campus durables ? Un sujet central dans la conception de ces campus est justement leur co-conception afin de les rendre adaptés aux besoins réels des étudiants. José Milano explique que les 20 campus d’OMNES sont conçus avec une participation continue des étudiants. À travers une approche test & learn, les espaces sont « constamment réajustés en fonction des retours des utilisateurs », garantissant ainsi qu’ils répondent aux attentes changeantes des étudiants.
Frédéric Meunier partage cette approche et a également impliqué les étudiants dès le départ dans la conception du campus de Villejuif en leur demandant leurs avis sur les espaces de travail, de vie, et de détente. La particularité de ce campus est d’être éclaté en différents bâtiments ayant chacun leur fonction propre : « Pour que le campus s’intègre au territoire, l’implication d’acteurs locaux et territoriaux comme la mairie de Villejuif a également été cruciale pour l’aménagement de l’espace urbain autour du campus, en facilitant l’accès et l’intégration du campus dans le tissu urbain ».
Pour clôturer la conférence, José Milano a identifié des tendances majeures pour l’avenir des campus. Face à des défis comme la concurrence accrue, la diminution démographique, et l’évolution rapide des attentes étudiantes, il a souligné la nécessité de rentabiliser les espaces : « Les campus devront offrir des espaces polyvalents et modulaires, capables de s’adapter rapidement aux changements ». Il a également proposé de densifier l’utilisation des espaces en les rendant accessibles à d’autres parties prenantes du territoire, ce qui permettrait de maximiser leur usage et de créer de nouveaux modèles économiques. Ces transformations sont selon lui « essentielles pour préparer les établissements d’enseignement supérieur aux enjeux futurs et garantir un impact positif sur la société à long terme ».
- Mai Lan Tran